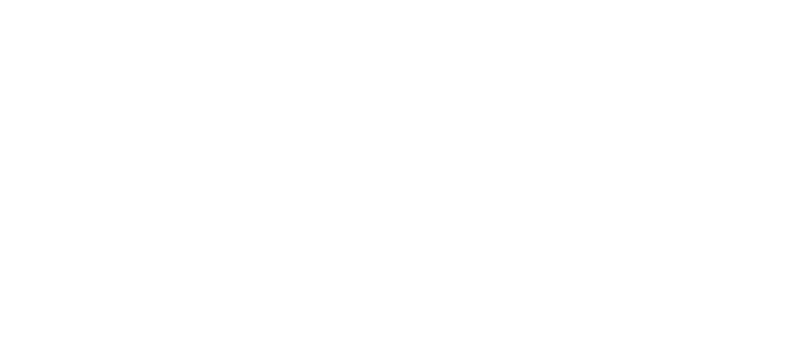Edito – Quelle histoire nous raconter ?
« Une communauté religieuse est un récit », selon Véronique Margron, présidente de la Corref, interviewée dans notre lettre de février. Un récit qui se transmet, dans et hors de la communauté.
Ce récit, notre histoire, est au cœur du travail de discernement et de réforme engagé depuis bientôt trois ans par Jérusalem. Il s’agit d’éclairer le passé, mais aussi – et peut-être surtout – de construire un avenir, un récit pour l’avenir, pour Jérusalem.
Un avenir qui se construit aussi au présent, grâce aux travaux menés par les sœurs comme les frères sur leurs propos fondamentaux. Ces propos, fondements renouvelés des communautés, s’inscrivent aussi dans ce dialogue entre passé en présent, dans cette succession de récits, pour retenir « les intuitions principales de Jérusalem ».
Notre réforme implique aussi une écriture de l’histoire que nous aurons à cœur de raconter à ceux qui viendront rejoindre Jérusalem : un récit de vérité ancré dans la durée, qui permettra à la mémoire comme à l’espérance de se transmettre de génération en génération. Cette réforme nécessite donc de nous regarder tels que nous sommes, aujourd’hui, d’interroger la lettre et l’esprit qui animent notre vie en communauté, car, comme l’écrivait Marc Bloch, « sans se pencher sur le présent, il est impossible de comprendre le passé. » Et aussi d’éclairer et de construire l’avenir.
L’équipe « Information » des Fraternités de Jérusalem.
Sœur Marie-Laure, sœur Marlene, frère Grégoire, frère Marc-Abraham
et Paul-Hervé Vintrou (membre des fraternités laïques de Jérusalem)

CHANTIER « TRAVAIL HISTORIQUE »
Pourquoi mener un travail historique ?

Interview et regard
de sœur Véronique Margron,
présidente de la Conférence des Religieux et Religieuses de France (Corref)
- Dans le processus de réforme que nous vivons, il nous a été demandé un travail historique. Ce travail est actuellement dirigé par le professeur Jean Pascal Gay de l’université de Louvain. A vos yeux, pourquoi est-il important pour une communauté aujourd’hui de relire son histoire ?
V.M. : Pour une communauté, il est toujours fondamental de relire son histoire, car une communauté religieuse est un récit et, par définition, un récit s’inscrit dans le temps. Il trouve sa source dans un moment, lui-même lié à un contexte ecclésial, social, politique, culturel, et ensuite c’est un récit porté par les personnes qui ont vécu de cette tradition tout au long de l’histoire de la communauté. Pour toute communauté, il est donc fondamental de relire son histoire, et pas seulement pour des communautés qui ont des soucis avec leurs fondateurs ou avec telle ou telle page de l’histoire. Car le propre de la vie religieuse est d’inscrire ses pas dans le récit de celles et ceux qui nous précèdent et d’espérer que nos propres pas donneront goût à d’autres, demain, d’y inscrire leurs propres pas. Cette dimension est essentielle, et d’autant plus essentielle pour des communautés où ont été opérées des déviances, des abus, des situations de souffrance liées à un moment de l’histoire en interne, pour arriver à recontextualiser : qu’est-ce qui a rendu possible ces abus ou ces déviances ? Pourquoi n’ont-elles pas, à l’époque, été signalées, dénoncées ? Quel est le contexte environnant, ecclésial, qui a favorisé l’impunité ? Et comment situer cette histoire particulière dans la grande histoire de la communauté ? Donc oui, c’est absolument fondamental.
- Quels risques y aurait-il à interroger l’histoire ? Ne vaut-il pas mieux laisser les ombres du passé pour s’ouvrir à l’avenir ?
V.M. : Ce sont les risques de la clarté ou de la vérité. Ou, en tout cas de la véracité, la vérité en train de se faire. À partir du moment où des témoins sont morts, c’est toujours difficile de dire qu’on va faire la vérité ; mais quelque chose de l’ordre de la vérité historique, comme on parle de la vérité judiciaire, qui n’est qu’une part de la vérité évidemment, peut faire peur parce qu’elle peut faire mal et que personne d’entre nous, et pas plus nos communautés religieuses, ne souhaite se confronter à des choses difficiles de leur histoire. Les choses difficiles de l’histoire, d’une manière ou d’une autre, nous remettent en cause aujourd’hui, interrogent nos manières de vivre aujourd’hui. Si je prends une page très ancienne de l’ordre de saint Dominique qui est la participation à l’Inquisition, ça remonte très loin, mais cela étant, ça interroge le rapport à la vérité, qui est la devise de l’ordre de saint Dominique : quand est-ce que le rapport à la vérité devient tellement dogmatique qu’il peut en devenir totalitaire ou excluant, voire oppressant envers d’autres, qui ne partageraient pas cette vérité telle que pensée par l’Église catholique par exemple, ou par les Dominicains de l’époque ou d’aujourd’hui ? Faire l’histoire, ce n’est pas seulement faire tomber éventuellement les statues du fondateur. Cela peut être vrai, mais c’est un aspect affectif. Interroger le présent est plus difficile et, évidemment, c’est pour cela qu’il est important de le faire. Si vous lisez le moindre ouvrage sur la question des secrets de famille, vous voyez que c’est ce qui se transmet le mieux, puisque ça se transmet de façon inconsciente. Il n’y a pas pire qu’un secret de famille qui ronge de l’intérieur sans que les générations suivantes comprennent pourquoi ça les ronge.
- En quoi cela concerne-t-il les membres nouvellement arrivés en communauté ou qui désireraient y entrer ?
V.M. : C’est utile pour les nouveaux car on ne peut pas mener une vie religieuse, entrer dans une communauté sur des illusions. Sur un type d’idéal, oui, heureusement, sur un désir de vie parfaite au sens de l’Évangile, pas parfaite au sens de la perfection morale, mais au sens d’essayer de suivre le Christ et de vivre dans le désir du Père. Tout cela ne peut se faire sur une illusion, sur un faux-semblant. Tout cela ne peut se faire sur un récit tronqué. Entrer dans la vie religieuse, ce n’est pas comme devenir prêtre diocésain, par exemple. Entrer dans la vie religieuse, c’est mettre ses pas dans les pas de ceux et celles qui nous ont précédé dans ce même récit. Si vous êtes prêtre diocésain et que vous entrez au séminaire dans un diocèse où il y a eu des choses terribles, c’est dramatique et mieux vaut le savoir, mais vous ne mettez pas vos pas dans ceux qui vous ont précédés. Dans la vie religieuse si, sinon on ne s’appellerait pas dominicaine, on ne s’appellerait pas communauté de Jérusalem. Le fait d’entrer dans un récit singulier oblige à ce labeur de vérité autant qu’il est possible. Sinon, pour reprendre une image évangélique, on construit sur du sable pour les nouvelles générations.
- Comme vous le savez, nos communautés ont vu partir ces dernières années beaucoup de leurs membres. Selon votre expérience, quels outils ou aides fournit le travail historique pour pouvoir relire ces départs, précédés souvent par des expériences d’abus spirituel ou des dysfonctionnements ?
V.M. : C’est difficile de vous répondre, mais je pense que la question est de savoir comment le travail historique ou socio-historique, parce qu’il est aussi toujours au croisement entre la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, comment ce travail est mis à disposition et travaillé par les communautés. S’il n’est pas travaillé par les communautés, il ne sert à rien. Si c’est seulement pour être publié à l’extérieur en disant : ‘Voilà on a fait le travail’, non seulement ça ne sert à rien, mais ça peut être profondément décourageant. Donc il n’est efficace – pour sa part parce qu’il ne peut pas être le seul lieu –, il n’a de fécondité, de pertinence pour la communauté que dans la mesure où elle va prendre les moyens de le travailler. C’est donc à voir avec l’équipe d’historiens pour qu’ils donnent une sorte de guide pédagogique. Tout le monde n’étant pas historien, le résultat du travail n’est pas toujours facile à lire. Qu’est-ce qui est mis à disposition pédagogiquement ?
Et puis qu’est-ce qui est mis à disposition comme tiers pour aider à travailler ? Peut-être que dans une communauté il est trop difficile de relire les départs. Il faut donc un tiers. Un tiers neutre qui peut être un ami de la communauté, pas forcément un psychologue ou un historien, mais simplement un ami de la communauté qui est suffisamment à distance pour ne pas prendre parti, mais qui est profondément bienveillant, évidemment.

PROPOS FONDAMENTAL
Qu’est-ce qu’un propos fondamental ?
Nous appelons propos fondamental un texte relativement concis (5 ou 6 pages) qui présente les principes essentiels de la vocation d’une communauté en explicitant son identité propre au sein de l’Église. Le propos fondamental définit les éléments qui guident et encadrent la vie des membres, leur appel, leur mode de consécration, leur spiritualité, leur manière de vivre les relations fraternelles en communauté et avec le monde, leur participation à la mission de l’Église.

Côté sœurs
Le processus de rédaction d’un propos fondamental
Rédiger un propos fondamental, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie tout simplement : chercher à exprimer les fondements sur lesquels repose notre vocation de sœurs de Jérusalem, tenter de recueillir dans un écrit les intuitions principales de Jérusalem.
Pour mener à bien ce travail d’écriture, nous avons commencé par lire et relire les comptes rendus des différents chantiers mis en œuvre en vue de la réforme ; nous nous sommes appuyées sur la réflexion menée depuis deux ans au sein de notre Institut.

Dans ce propos fondamental, le travail de chaque sœur est donc représenté. Mais ensuite, le défi pour notre comité de rédaction était de ne pas se contenter de faire une synthèse des comptes rendus des chantiers, mais d’essayer d’écrire un texte animé par un souffle, une visée.
Pour rédiger ce propos, nous avons aussi pensé qu’il était important de partir de ce que nous vivons, c’est-à-dire d’exprimer la spiritualité de Jérusalem non pas de façon abstraite ou idéalisée, mais en écrivant un texte porté par une expérience commune. Ce propos fondamental traduit, certes, un idéal, mais nous avons cherché à ce qu’il soit aussi concret, incarné, loin de toute spiritualisation.
Enfin, un des enjeux pour nous était d’actualiser les intuitions fondamentales de Jérusalem. Autrement dit d’enraciner notre propos dans une histoire et en même temps de parler de notre vocation aujourd’hui, avec les mots d’aujourd’hui. Et d’indiquer aussi ce vers quoi nous voulons tendre.
Au bout du compte, un propos fondamental assez développé (cinq pages) a vu le jour. Les sœurs sont maintenant invitées à se l’approprier et à le discuter en fraternité et au sein de groupes inter-fraternités.
Sœur Jeanne

Côté frères
Cheminer vers des Constitutions
Dans le cadre de la réforme de nos instituts et suite à la demande de Rome (DIVCSVA) de « mieux exprimer le charisme qui nous est propre », quelques frères du conseil général ont été missionnés à l’automne 2023 pour commencer la rédaction d’un document qui cherche à formuler la vocation des frères de Jérusalem et à en identifier les fondements. Ils ont largement puisé dans le travail effectué par les chantiers de la réforme, ainsi que dans les échanges entre frères lors de nos assemblées à La Flatière (janvier 2023) et à Burtin (août 2023).

Un premier document a été rédigé, enrichi d’apports à la suite de consultations de frères de l’institut, de laïcs proches de nos communautés, d’autres religieux, de théologiens, etc…
Fin janvier 2024, il a été étudié et discuté par les frères prieurs réunis à l’abbaye de Scourmont. Ils ont ainsi proposé une pédagogie pour que le travail puisse se poursuivre en fraternités. Ce document de travail intitulé « La vocation des frères de Jérusalem aujourd’hui », a été reçu par les fraternités au printemps 2024 pour un temps d’appropriation et de débat. Chaque fraternité a en effet pu échanger et affiner la proposition en vue de l’assemblée de Burtin de fin août 2024, lors de laquelle un texte d’ensemble a été voté, qui sert actuellement de base pour la rédaction des Constitutions et les orientations de formation. Ce texte, intitulé La vocation des frères de Jérusalem aujourd’hui – Propos fondamental, présente, avec les mots qui sont les nôtres pour aujourd’hui, notre identité de moines comme une vocation monastique devant Dieu, dans et avec le monde. Vocation vécue selon un style fraternel et en rapport au monde dans le mode de l’hospitalité, c’est-à-dire dans une attitude communautaire d’écoute et d’accueil de ceux que nous rencontrons. Notre vocation est inspirée par la figure biblique de Jérusalem qui nous fait voir le monde dans la lumière de l’espérance du salut. Elle informe pour nous les deux moments importants de notre vie que sont la liturgie et le travail.
Au-delà du texte, l’expérience vécue a été elle-même un apprentissage avec des étapes qui nous façonnent et font grandir la maturité du corps que nous formons pour construire ensemble nos orientations communautaires. Nous avons souligné la nécessité d’opérer des choix et de les hiérarchiser, c’est-à-dire d’apprendre à renoncer à vivre tout ce qui est possible pour mieux se recentrer sur le cœur de notre appel dans les réalités du monde d’aujourd’hui.
Ce texte d’orientation est la base de travail pour la rédaction des nouvelles constitutions, texte juridique décrivant la vocation et la règle de vie des frères, leur mode de gouvernement, leur formation, l’administration économique des biens et les relations avec l’Église. Un projet vient d’être élaboré par le conseil en lien avec les assistants apostoliques et avec l’expertise d’un canoniste. A partir de ce mois de février, l’élaboration du projet se poursuit en fraternités avec la contribution de chaque frère. L’objectif est de présenter ce texte au vote de l’assemblée générale des frères en juin.
Frères Grégoire et Marc-Abraham

LA RÉFORME EN ACTES
De nouvelles modalités pour exercer la responsabilité
des églises qui nous sont confiées
Depuis plusieurs mois, plusieurs de nos implantations connaissent des évolutions concernant les charges rectorales des églises qui nous sont confiées.
Alors que plusieurs mandats de recteur/chapelain se terminaient, les frères prêtres ont été interrogés sur leur disponibilité et leur capacité à assumer de telles charges. Notre précarité actuelle a été l’occasion d’une réflexion plus profonde sur les responsabilités pastorales que les évêques pouvaient confier à certains de nos frères prêtres. Nous avons saisi cette opportunité pour ouvrir des espaces de parole (entre frères et parfois entre frères et sœurs) afin de trouver des réponses à cette problématique et des solutions adaptées à notre vocation monastique. Les partages fraternels ont été riches et nous ont conduit progressivement à préciser les évolutions qui nous semblaient nécessaires. En dialogue avec les évêques, nous avons souhaité chercher de nouvelles modalités pour participer autrement à l’exercice de la charge pastorale des églises qui nous sont confiées.
Jusque-là en effet, il était d’usage que le prieur, lorsqu’il était prêtre, assumait lui-même la fonction de recteur ou de chapelain. L’expérience a toutefois montré que cette double responsabilité n’était pas évidente à assumer. La double charge de travail était imposante et difficile à porter correctement ; plusieurs frères ont été usés par cette surcharge. Par ailleurs, cette double responsabilité générait de la confusion et des tensions dans les collaborations entre frères ou entre frères et sœurs. Les lieux communs sont régulièrement l’objet d’enjeux de pouvoir et de conflits d’autorité qu’il est difficile de dépasser sans s’ouvrir à un tiers externe, en l’occurrence ici l’Église locale qui nous missionne. Une différenciation devenait indispensable afin de mieux saisir les domaines de responsabilités (civil et canonique) et de mieux assumer les charges ainsi confiées.
Dans certains cas, l’évêque a choisi de nommer un prêtre diocésain pour reprendre la charge rectorale. Une collaboration entre le recteur, les sœurs et les frères s’ouvre alors de manière à définir ensemble les dynamiques pastorales ainsi que les instances de concertation et de décision de ces orientations communes. C’est le choix retenu par l’archevêque de Sens-Auxerre pour ce qui concerne le sanctuaire de Vézelay avec sa basilique, ses hôtelleries et son magasin, désormais gérés par le diocèse en collaboration avec nos fraternités, sous la responsabilité du père Olivier Artus, recteur de la basilique.
Une autre solution consiste à confier l’exercice de la charge pastorale à une équipe de laïcs, sous la vigilance plus lointaine d’un prêtre modérateur. Cette configuration (inspirée du Can. 517§2) se développe de plus en plus dans les diocèses en manque de prêtres. Elle permet à des laïcs et des consacrés nommés par l’évêque d’assumer ensemble les différents aspects de la charge rectorale : les affaires temporelles (notamment la responsabilité civile), les orientations pastorales et les célébrations liturgiques avec toutes les délégations ministérielles nécessaires. Ce fonctionnement repose sur un dialogue régulier et sur la pratique du discernement ecclésial dans le respect des vocations propres de chacun. Il met en évidence la fraternité vécue en Église au service de la mission. C’est la configuration que nous expérimentons depuis plusieurs mois à Paris où un « quatuor » (composé d’un administrateur laïc pour les affaires temporelles et des deux prieurs et du diacre, Julien Pradayrol pour l’animation spirituelle et pastorale) a été nommé par l’archevêque pour assumer ces différentes charges.

Bénédiction et envoi de l’équipe en responsabilité pour l’église Saint-Gervais à Paris, le 1er novembre 2025
Ces évolutions mettent ainsi en évidence nos spécificités vocationnelles. Elles nous font approfondir notamment et concrètement la communion entre frères et sœurs et la collaboration active avec les laïcs. Plus largement ces évolutions ont été l’occasion de revisiter avec les évêques des diocèses les missions qui nous étaient confiées. Des lettres de mission et des conventions de moyen ont été signées, permettant ainsi de clarifier notre participation à la mission de l’Église locale en tant que moines et moniales.
Frère Charles

© 2025 Fraternités Monastiques de Jérusalem
Lettre d’information « Discernement & réforme » – communication@fraternites-jerusalem.org
Edito – Quelle histoire nous raconter ?
« Une communauté religieuse est un récit », selon Véronique Margron, présidente de la Corref, interviewée dans notre lettre de février. Un récit qui se transmet, dans et hors de la communauté.
Ce récit, notre histoire, est au cœur du travail de discernement et de réforme engagé depuis bientôt trois ans par Jérusalem. Il s’agit d’éclairer le passé, mais aussi – et peut-être surtout – de construire un avenir, un récit pour l’avenir, pour Jérusalem.
Un avenir qui se construit aussi au présent, grâce aux travaux menés par les sœurs comme les frères sur leurs propos fondamentaux. Ces propos, fondements renouvelés des communautés, s’inscrivent aussi dans ce dialogue entre passé en présent, dans cette succession de récits, pour retenir « les intuitions principales de Jérusalem ».
Notre réforme implique aussi une écriture de l’histoire que nous aurons à cœur de raconter à ceux qui viendront rejoindre Jérusalem : un récit de vérité ancré dans la durée, qui permettra à la mémoire comme à l’espérance de se transmettre de génération en génération. Cette réforme nécessite donc de nous regarder tels que nous sommes, aujourd’hui, d’interroger la lettre et l’esprit qui animent notre vie en communauté, car, comme l’écrivait Marc Bloch, « sans se pencher sur le présent, il est impossible de comprendre le passé. » Et aussi d’éclairer et de construire l’avenir.
L’équipe « Information » des Fraternités de Jérusalem.
Sœur Marie-Laure, sœur Marlene, frère Grégoire, frère Marc-Abraham
et Paul-Hervé Vintrou (membre des fraternités laïques de Jérusalem)

CHANTIER « TRAVAIL HISTORIQUE »
Pourquoi mener un travail historique ?

Interview et regard
de sœur Véronique Margron,
présidente de la Conférence des Religieux et Religieuses de France (Corref)
- Dans le processus de réforme que nous vivons, il nous a été demandé un travail historique. Ce travail est actuellement dirigé par le professeur Jean Pascal Gay de l’université de Louvain. A vos yeux, pourquoi est-il important pour une communauté aujourd’hui de relire son histoire ?
V.M. : Pour une communauté, il est toujours fondamental de relire son histoire, car une communauté religieuse est un récit et, par définition, un récit s’inscrit dans le temps. Il trouve sa source dans un moment, lui-même lié à un contexte ecclésial, social, politique, culturel, et ensuite c’est un récit porté par les personnes qui ont vécu de cette tradition tout au long de l’histoire de la communauté. Pour toute communauté, il est donc fondamental de relire son histoire, et pas seulement pour des communautés qui ont des soucis avec leurs fondateurs ou avec telle ou telle page de l’histoire. Car le propre de la vie religieuse est d’inscrire ses pas dans le récit de celles et ceux qui nous précèdent et d’espérer que nos propres pas donneront goût à d’autres, demain, d’y inscrire leurs propres pas. Cette dimension est essentielle, et d’autant plus essentielle pour des communautés où ont été opérées des déviances, des abus, des situations de souffrance liées à un moment de l’histoire en interne, pour arriver à recontextualiser : qu’est-ce qui a rendu possible ces abus ou ces déviances ? Pourquoi n’ont-elles pas, à l’époque, été signalées, dénoncées ? Quel est le contexte environnant, ecclésial, qui a favorisé l’impunité ? Et comment situer cette histoire particulière dans la grande histoire de la communauté ? Donc oui, c’est absolument fondamental.
- Quels risques y aurait-il à interroger l’histoire ? Ne vaut-il pas mieux laisser les ombres du passé pour s’ouvrir à l’avenir ?
V.M. : Ce sont les risques de la clarté ou de la vérité. Ou, en tout cas de la véracité, la vérité en train de se faire. À partir du moment où des témoins sont morts, c’est toujours difficile de dire qu’on va faire la vérité ; mais quelque chose de l’ordre de la vérité historique, comme on parle de la vérité judiciaire, qui n’est qu’une part de la vérité évidemment, peut faire peur parce qu’elle peut faire mal et que personne d’entre nous, et pas plus nos communautés religieuses, ne souhaite se confronter à des choses difficiles de leur histoire. Les choses difficiles de l’histoire, d’une manière ou d’une autre, nous remettent en cause aujourd’hui, interrogent nos manières de vivre aujourd’hui. Si je prends une page très ancienne de l’ordre de saint Dominique qui est la participation à l’Inquisition, ça remonte très loin, mais cela étant, ça interroge le rapport à la vérité, qui est la devise de l’ordre de saint Dominique : quand est-ce que le rapport à la vérité devient tellement dogmatique qu’il peut en devenir totalitaire ou excluant, voire oppressant envers d’autres, qui ne partageraient pas cette vérité telle que pensée par l’Église catholique par exemple, ou par les Dominicains de l’époque ou d’aujourd’hui ? Faire l’histoire, ce n’est pas seulement faire tomber éventuellement les statues du fondateur. Cela peut être vrai, mais c’est un aspect affectif. Interroger le présent est plus difficile et, évidemment, c’est pour cela qu’il est important de le faire. Si vous lisez le moindre ouvrage sur la question des secrets de famille, vous voyez que c’est ce qui se transmet le mieux, puisque ça se transmet de façon inconsciente. Il n’y a pas pire qu’un secret de famille qui ronge de l’intérieur sans que les générations suivantes comprennent pourquoi ça les ronge.
- En quoi cela concerne-t-il les membres nouvellement arrivés en communauté ou qui désireraient y entrer ?
V.M. : C’est utile pour les nouveaux car on ne peut pas mener une vie religieuse, entrer dans une communauté sur des illusions. Sur un type d’idéal, oui, heureusement, sur un désir de vie parfaite au sens de l’Évangile, pas parfaite au sens de la perfection morale, mais au sens d’essayer de suivre le Christ et de vivre dans le désir du Père. Tout cela ne peut se faire sur une illusion, sur un faux-semblant. Tout cela ne peut se faire sur un récit tronqué. Entrer dans la vie religieuse, ce n’est pas comme devenir prêtre diocésain, par exemple. Entrer dans la vie religieuse, c’est mettre ses pas dans les pas de ceux et celles qui nous ont précédé dans ce même récit. Si vous êtes prêtre diocésain et que vous entrez au séminaire dans un diocèse où il y a eu des choses terribles, c’est dramatique et mieux vaut le savoir, mais vous ne mettez pas vos pas dans ceux qui vous ont précédés. Dans la vie religieuse si, sinon on ne s’appellerait pas dominicaine, on ne s’appellerait pas communauté de Jérusalem. Le fait d’entrer dans un récit singulier oblige à ce labeur de vérité autant qu’il est possible. Sinon, pour reprendre une image évangélique, on construit sur du sable pour les nouvelles générations.
- Comme vous le savez, nos communautés ont vu partir ces dernières années beaucoup de leurs membres. Selon votre expérience, quels outils ou aides fournit le travail historique pour pouvoir relire ces départs, précédés souvent par des expériences d’abus spirituel ou des dysfonctionnements ?
V.M. : C’est difficile de vous répondre, mais je pense que la question est de savoir comment le travail historique ou socio-historique, parce qu’il est aussi toujours au croisement entre la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, comment ce travail est mis à disposition et travaillé par les communautés. S’il n’est pas travaillé par les communautés, il ne sert à rien. Si c’est seulement pour être publié à l’extérieur en disant : ‘Voilà on a fait le travail’, non seulement ça ne sert à rien, mais ça peut être profondément décourageant. Donc il n’est efficace – pour sa part parce qu’il ne peut pas être le seul lieu –, il n’a de fécondité, de pertinence pour la communauté que dans la mesure où elle va prendre les moyens de le travailler. C’est donc à voir avec l’équipe d’historiens pour qu’ils donnent une sorte de guide pédagogique. Tout le monde n’étant pas historien, le résultat du travail n’est pas toujours facile à lire. Qu’est-ce qui est mis à disposition pédagogiquement ?
Et puis qu’est-ce qui est mis à disposition comme tiers pour aider à travailler ? Peut-être que dans une communauté il est trop difficile de relire les départs. Il faut donc un tiers. Un tiers neutre qui peut être un ami de la communauté, pas forcément un psychologue ou un historien, mais simplement un ami de la communauté qui est suffisamment à distance pour ne pas prendre parti, mais qui est profondément bienveillant, évidemment.

PROPOS FONDAMENTAL
Qu’est-ce qu’un propos fondamental ?
Nous appelons propos fondamental un texte relativement concis (5 ou 6 pages) qui présente les principes essentiels de la vocation d’une communauté en explicitant son identité propre au sein de l’Église. Le propos fondamental définit les éléments qui guident et encadrent la vie des membres, leur appel, leur mode de consécration, leur spiritualité, leur manière de vivre les relations fraternelles en communauté et avec le monde, leur participation à la mission de l’Église.

Côté sœurs
Le processus de rédaction d’un propos fondamental
Rédiger un propos fondamental, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie tout simplement : chercher à exprimer les fondements sur lesquels repose notre vocation de sœurs de Jérusalem, tenter de recueillir dans un écrit les intuitions principales de Jérusalem.
Pour mener à bien ce travail d’écriture, nous avons commencé par lire et relire les compte-rendus des différents chantiers mis en œuvre en vue de la réforme ; nous nous sommes appuyées sur la réflexion menée depuis deux ans au sein de notre Institut.

Dans ce propos fondamental, le travail de chaque sœur est donc représenté. Mais ensuite, le défi pour notre comité de rédaction était de ne pas se contenter de faire une synthèse des compte-rendus des chantiers, mais d’essayer d’écrire un texte animé par un souffle, une visée.
Pour rédiger ce propos, nous avons aussi pensé qu’il était important de partir de ce que nous vivons, c’est-à-dire d’exprimer la spiritualité de Jérusalem non pas de façon abstraite ou idéalisée, mais en écrivant un texte porté par une expérience commune. Ce propos fondamental traduit, certes, un idéal, mais nous avons cherché à ce qu’il soit aussi concret, incarné, loin de toute spiritualisation.
Enfin, un des enjeux pour nous était d’actualiser les intuitions fondamentales de Jérusalem. Autrement dit d’enraciner notre propos dans une histoire et en même temps de parler de notre vocation aujourd’hui, avec les mots d’aujourd’hui. Et d’indiquer aussi ce vers quoi nous voulons tendre.
Au bout du compte, un propos fondamental assez développé (cinq pages) a vu le jour. Les sœurs sont maintenant invitées à se l’approprier et à le discuter en fraternité et au sein de groupes inter-fraternités.
Sœur Jeanne

Côté frères
Cheminer vers des Constitutions
Dans le cadre de la réforme de nos instituts et suite à la demande de Rome (DIVCSVA) de « mieux exprimer le charisme qui nous est propre », quelques frères du conseil général ont été missionnés à l’automne 2023 pour commencer la rédaction d’un document qui cherche à formuler la vocation des frères de Jérusalem et à en identifier les fondements. Ils ont largement puisé dans le travail effectué par les chantiers de la réforme, ainsi que dans les échanges entre frères lors de nos assemblées à La Flatière (janvier 2023) et à Burtin (août 2023).

Un premier document a été rédigé, enrichi d’apports à la suite de consultations de frères de l’institut, de laïcs proches de nos communautés, d’autres religieux, de théologiens, etc…
Fin janvier 2024, il a été étudié et discuté par les frères prieurs réunis à l’abbaye de Scourmont. Ils ont ainsi proposé une pédagogie pour que le travail puisse se poursuivre en fraternités. Ce document de travail intitulé « La vocation des frères de Jérusalem aujourd’hui », a été reçu par les fraternités au printemps 2024 pour un temps d’appropriation et de débat. Chaque fraternité a en effet pu échanger et affiner la proposition en vue de l’assemblée de Burtin de fin août 2024, lors de laquelle un texte d’ensemble a été voté, qui sert actuellement de base pour la rédaction des Constitutions et les orientations de formation. Ce texte, intitulé La vocation des frères de Jérusalem aujourd’hui – Propos fondamental, présente, avec les mots qui sont les nôtres pour aujourd’hui, notre identité de moines comme une vocation monastique devant Dieu, dans et avec le monde. Vocation vécue selon un style fraternel et en rapport au monde dans le mode de l’hospitalité, c’est-à-dire dans une attitude communautaire d’écoute et d’accueil de ceux que nous rencontrons. Notre vocation est inspirée par la figure biblique de Jérusalem qui nous fait voir le monde dans la lumière de l’espérance du salut. Elle informe pour nous les deux moments importants de notre vie que sont la liturgie et le travail.
Au-delà du texte, l’expérience vécue a été elle-même un apprentissage avec des étapes qui nous façonnent et font grandir la maturité du corps que nous formons pour construire ensemble nos orientations communautaires. Nous avons souligné la nécessité d’opérer des choix et de les hiérarchiser, c’est-à-dire d’apprendre à renoncer à vivre tout ce qui est possible pour mieux se recentrer sur le cœur de notre appel dans les réalités du monde d’aujourd’hui.
Ce texte d’orientation est la base de travail pour la rédaction des nouvelles constitutions, texte juridique décrivant la vocation et la règle de vie des frères, leur mode de gouvernement, leur formation, l’administration économique des biens et les relations avec l’Église. Un projet vient d’être élaboré par le conseil en lien avec les assistants apostoliques et avec l’expertise d’un canoniste. A partir de ce mois de février, l’élaboration du projet se poursuit en fraternités avec la contribution de chaque frère. L’objectif est de présenter ce texte au vote de l’assemblée générale des frères en juin.
Frères Grégoire et Marc-Abraham

LA RÉFORME EN ACTES
De nouvelles modalités pour exercer la responsabilité
des églises qui nous sont confiées
Depuis plusieurs mois, plusieurs de nos implantations connaissent des évolutions concernant les charges rectorales des églises qui nous sont confiées.
Alors que plusieurs mandats de recteur/chapelain se terminaient, les frères prêtres ont été interrogés sur leur disponibilité et leur capacité à assumer de telles charges. Notre précarité actuelle a été l’occasion d’une réflexion plus profonde sur les responsabilités pastorales que les évêques pouvaient confier à certains de nos frères prêtres. Nous avons saisi cette opportunité pour ouvrir des espaces de parole (entre frères et parfois entre frères et sœurs) afin de trouver des réponses à cette problématique et des solutions adaptées à notre vocation monastique. Les partages fraternels ont été riches et nous ont conduit progressivement à préciser les évolutions qui nous semblaient nécessaires. En dialogue avec les évêques, nous avons souhaité chercher de nouvelles modalités pour participer autrement à l’exercice de la charge pastorale des églises qui nous sont confiées.
Jusque là en effet, il était d’usage que le prieur, lorsqu’il était prêtre, assumait lui-même la fonction de recteur ou de chapelain. L’expérience a toutefois montré que cette double responsabilité n’était pas évidente à assumer. La double charge de travail était imposante et difficile à porter correctement; plusieurs frères ont été usés par cette surcharge. Par ailleurs, cette double responsabilité générait de la confusion et des tensions dans les collaborations entre frères ou entre frères et sœurs. Les lieux communs sont régulièrement l’objet d’enjeux de pouvoir et de conflits d’autorité qu’il est difficile de dépasser sans s’ouvrir à un tiers externe, en l’occurrence ici l’Église locale qui nous missionne. Une différenciation devenait indispensable afin de mieux saisir les domaines de responsabilités (civil et canonique) et de mieux assumer les charges ainsi confiées.
Dans certains cas, l’évêque a choisi de nommer un prêtre diocésain pour reprendre la charge rectorale. Une collaboration entre le recteur, les sœurs et les frères s’ouvre alors de manière à définir ensemble les dynamiques pastorales ainsi que les instances de concertation et de décision de ces orientations communes. C’est le choix retenu par l’archevêque de Sens-Auxerre pour ce qui concerne le sanctuaire de Vézelay avec sa basilique, ses hôtelleries et son magasin, désormais gérés par le diocèse en collaboration avec nos fraternités, sous la responsabilité du père Olivier Artus, recteur de la basilique.
Une autre solution consiste à confier l’exercice de la charge pastorale à une équipe de laïcs, sous la vigilance plus lointaine d’un prêtre modérateur. Cette configuration (inspirée du Can. 517§2) se développe de plus en plus dans les diocèses en manque de prêtres. Elle permet à des laïcs et des consacrés nommés par l’évêque d’assumer ensemble les différents aspects de la charge rectorale : les affaires temporelles (notamment la responsabilité civile), les orientations pastorales et les célébrations liturgiques avec toutes les délégations ministérielles nécessaires. Ce fonctionnement repose sur un dialogue régulier et sur la pratique du discernement ecclésial dans le respect des vocations propres de chacun. Il met en évidence la fraternité vécue en Église au service de la mission. C’est la configuration que nous expérimentons depuis plusieurs mois à Paris où un « quatuor » (composé d’un administrateur laïc pour les affaires temporelles et des deux prieurs et du diacre, Julien Pradayrol pour l’animation spirituelle et pastorale) a été nommé par l’archevêque pour assumer ces différentes charges.

Bénédiction et envoi de l’équipe en responsabilité pour l’église Saint-Gervais à Paris, le 1er novembre 2025
Ces évolutions mettent ainsi en évidence nos spécificités vocationnelles. Elles nous font approfondir notamment et concrètement la communion entre frères et sœurs et la collaboration active avec les laïcs. Plus largement ces évolutions ont été l’occasion de revisiter avec les évêques des diocèses les missions qui nous étaient confiées. Des lettres de mission et des conventions de moyen ont été signées, permettant ainsi de clarifier notre participation à la mission de l’Église locale en tant que moines et moniales.
Frère Charles

© 2025 Fraternités Monastiques de Jérusalem
Lettre d’information « Discernement & réforme » – communication@fraternites-jerusalem.org