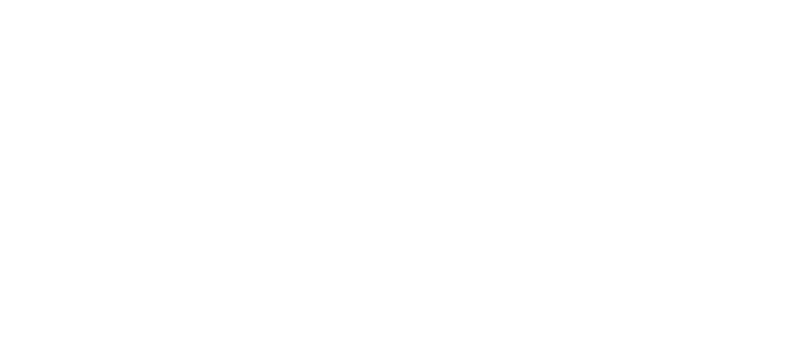COMPLÉMENT À LA LETTRE D’INFORMATION N°8 – MARS 2025
Pourquoi mener un travail historique ?

Interview et regard de sœur Véronique Margron,
présidente de la Conférence des Religieux et Religieuses de France (Corref)

- Dans le processus de réforme que nous vivons, il nous a été demandé un travail historique. Ce travail est actuellement dirigé par le professeur Jean Pascal Gay de l’université de Louvain. A vos yeux, pourquoi est-il important pour une communauté aujourd’hui de relire son histoire ?
V.M. : Pour une communauté, il est toujours fondamental de relire son histoire, car une communauté religieuse est un récit et, par définition, un récit s’inscrit dans le temps. Il trouve sa source dans un moment, lui-même lié à un contexte ecclésial, social, politique, culturel, et ensuite c’est un récit porté par les personnes qui ont vécu de cette tradition tout au long de l’histoire de la communauté. Pour toute communauté, il est donc fondamental de relire son histoire, et pas seulement pour des communautés qui ont des soucis avec leurs fondateurs ou avec telle ou telle page de l’histoire. Car le propre de la vie religieuse est d’inscrire ses pas dans le récit de celles et ceux qui nous précèdent et d’espérer que nos propres pas donneront goût à d’autres, demain, d’y inscrire leurs propres pas. Cette dimension est essentielle, et d’autant plus essentielle pour des communautés où ont été opérées des déviances, des abus, des situations de souffrance liées à un moment de l’histoire en interne, pour arriver à recontextualiser : qu’est-ce qui a rendu possible ces abus ou ces déviances ? Pourquoi n’ont-elles pas, à l’époque, été signalées, dénoncées ? Quel est le contexte environnant, ecclésial, qui a favorisé l’impunité ? Et comment situer cette histoire particulière dans la grande histoire de la communauté ? Donc oui, c’est absolument fondamental.
- Quels risques y aurait-il à interroger l’histoire ? Ne vaut-il pas mieux laisser les ombres du passé pour s’ouvrir à l’avenir ?
V.M. : Ce sont les risques de la clarté ou de la vérité. Ou, en tout cas de la véracité, la vérité en train de se faire. À partir du moment où des témoins sont morts, c’est toujours difficile de dire qu’on va faire la vérité ; mais quelque chose de l’ordre de la vérité historique, comme on parle de la vérité judiciaire, qui n’est qu’une part de la vérité évidemment, peut faire peur parce qu’elle peut faire mal et que personne d’entre nous, et pas plus nos communautés religieuses, ne souhaite se confronter à des choses difficiles de leur histoire. Les choses difficiles de l’histoire, d’une manière ou d’une autre, nous remettent en cause aujourd’hui, interrogent nos manières de vivre aujourd’hui. Si je prends une page très ancienne de l’ordre de saint Dominique qui est la participation à l’Inquisition, ça remonte très loin, mais cela étant, ça interroge le rapport à la vérité, qui est la devise de l’ordre de saint Dominique : quand est-ce que le rapport à la vérité devient tellement dogmatique qu’il peut en devenir totalitaire ou excluant, voire oppressant envers d’autres, qui ne partageraient pas cette vérité telle que pensée par l’Église catholique par exemple, ou par les Dominicains de l’époque ou d’aujourd’hui ? Faire l’histoire, ce n’est pas seulement faire tomber éventuellement les statues du fondateur. Cela peut être vrai, mais c’est un aspect affectif. Interroger le présent est plus difficile et, évidemment, c’est pour cela qu’il est important de le faire. Si vous lisez le moindre ouvrage sur la question des secrets de famille, vous voyez que c’est ce qui se transmet le mieux, puisque ça se transmet de façon inconsciente. Il n’y a pas pire qu’un secret de famille qui ronge de l’intérieur sans que les générations suivantes comprennent pourquoi ça les ronge.
- En quoi cela concerne-t-il les membres nouvellement arrivés en communauté ou qui désireraient y entrer ?
V.M. : C’est utile pour les nouveaux car on ne peut pas mener une vie religieuse, entrer dans une communauté sur des illusions. Sur un type d’idéal, oui, heureusement, sur un désir de vie parfaite au sens de l’Évangile, pas parfaite au sens de la perfection morale, mais au sens d’essayer de suivre le Christ et de vivre dans le désir du Père. Tout cela ne peut se faire sur une illusion, sur un faux-semblant. Tout cela ne peut se faire sur un récit tronqué. Entrer dans la vie religieuse, ce n’est pas comme devenir prêtre diocésain, par exemple. Entrer dans la vie religieuse, c’est mettre ses pas dans les pas de ceux et celles qui nous ont précédé dans ce même récit. Si vous êtes prêtre diocésain et que vous entrez au séminaire dans un diocèse où il y a eu des choses terribles, c’est dramatique et mieux vaut le savoir, mais vous ne mettez pas vos pas dans ceux qui vous ont précédés. Dans la vie religieuse si, sinon on ne s’appellerait pas dominicaine, on ne s’appellerait pas communauté de Jérusalem. Le fait d’entrer dans un récit singulier oblige à ce labeur de vérité autant qu’il est possible. Sinon, pour reprendre une image évangélique, on construit sur du sable pour les nouvelles générations.
- Comme vous le savez, nos communautés ont vu partir ces dernières années beaucoup de leurs membres. Selon votre expérience, quels outils ou aides fournit le travail historique pour pouvoir relire ces départs, précédés souvent par des expériences d’abus spirituel ou des dysfonctionnements ?
V.M. : C’est difficile de vous répondre, mais je pense que la question est de savoir comment le travail historique ou socio-historique, parce qu’il est aussi toujours au croisement entre la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, comment ce travail est mis à disposition et travaillé par les communautés. S’il n’est pas travaillé par les communautés, il ne sert à rien. Si c’est seulement pour être publié à l’extérieur en disant : ‘Voilà on a fait le travail’, non seulement ça ne sert à rien, mais ça peut être profondément décourageant. Donc il n’est efficace – pour sa part parce qu’il ne peut pas être le seul lieu –, il n’a de fécondité, de pertinence pour la communauté que dans la mesure où elle va prendre les moyens de le travailler. C’est donc à voir avec l’équipe d’historiens pour qu’ils donnent une sorte de guide pédagogique. Tout le monde n’étant pas historien, le résultat du travail n’est pas toujours facile à lire. Qu’est-ce qui est mis à disposition pédagogiquement ?
Et puis qu’est-ce qui est mis à disposition comme tiers pour aider à travailler ? Peut-être que dans une communauté il est trop difficile de relire les départs. Il faut donc un tiers. Un tiers neutre qui peut être un ami de la communauté, pas forcément un psychologue ou un historien, mais simplement un ami de la communauté qui est suffisamment à distance pour ne pas prendre parti, mais qui est profondément bienveillant, évidemment.

V.M. : Le danger que je vois dans un certain nombre de lieux, c’est que le travail est fait et qu’au moment même où il a été fait, il tombe dans une sorte de déni. La communauté ne s’en saisit pas. Elle le lit de loin, écoute la synthèse, mais cela n’a pas d’effet de transformation. Car la question est là : ce n’est pas simplement de dire que nous avons l’obligation éthique, évangélique, de faire la clarté, autant que faire se peut, sur des pages sombres. Le but, c’est de dire comment ça nous transforme pour que nous soyons plus évangéliques aujourd’hui. Plus conforme à l’Évangile et donc plus conforme à l’humain, à la dignité humaine. Et cela, c’est un travail au long cours. Il ne suffit pas d’avoir fait le rapport, de le publier et d’en faire la synthèse. Ce travail-là doit être fait au fil de l’eau, au fil de la vie. Ne serait-ce que par la confrontation à ce travail et à la compréhension des abus, des situations de souffrance, de ceux ou celles qui sont partis ou qui sont restés. Pour moi, l’enjeu est donc d’avoir un tiers qui tient bon.
- Certains de ceux qui sont partis sont apaisés et d’autres sont encore très meurtris et bouleversés. Est-ce qu’on peut aller vers eux avec ce travail de relecture ou est-ce que c’est intrusif de se retourner vers eux pour relire ensemble cette histoire ?
V.M. : Il faut leur demander à chacun, il ne peut pas y avoir de réponse collective, ça dépend des itinéraires individuels. Tout dépend de ce que les personnes ont vécu depuis qu’elles sont parties. Mais je dirais que ça peut vite être intrusif. Est-ce que beaucoup le veulent ? Je ne sais pas si c’est le cas pour vous, à Jérusalem, mais je vois dans d’autres communautés que non seulement beaucoup ne veulent plus en entendre parler, mais qu’il faut qu’ils n’en entendent plus parler pour pouvoir mener leur vie. À un moment donné, il faut quand même s’arracher. Cela ne veut pas dire qu’on a oublié à l’intérieur de soi évidemment, mais il faut s’arracher parce qu’il faut mener sa vie. Il faut être responsable, trouver du travail, faire toutes les choses pour lesquelles il n’y a plus de communauté pour vous soutenir. Je pense donc qu’il faut leur communiquer, leur dire qu’éventuellement vous êtes à leur disposition pour en parler s’ils le souhaitent. C’est bien, mais pas plus, parce je vois des frères et des sœurs qui ont quitté depuis des années et qui dans leur tête sont toujours attachés et ça peut être très problématique pour leur insertion aujourd’hui. La vie, c’est dur, donc ça requiert de l’énergie et on ne peut pas mettre son énergie partout.
- Il y a aussi souvent un décalage entre ceux qui disent que le travail de réforme est juste un replâtrage qui maquille les problèmes de fond, et à l’intérieur, ceux qui disent : on en a assez, on n’en peut plus. Comment alors trouver un juste équilibre dans ce travail ?
V.M. : C’est bien difficile, c’est vrai. Il faut être honnête, je pense qu’on navigue forcément à vue. C’est impossible de trouver à tout moment la bonne mesure. Et puis il y a des moments paroxystiques, par exemple la sortie de votre rapport. Le chemin – mais je le dis vraiment avec précaution – c’est sans doute le travail au long cours. Que ce ne soit pas le centre de la vie, mais un travail long. Cela va dépendre de l’importance du rapport effectué, mais c’est un travail dans les communautés d’au moins deux ans. Que ça ne devienne pas obsessionnel, mais en même temps qu’on ne se dise pas : ‘allez, on y passe trois jours de session, et après on n’en parle plus’. C’est un travail de deux ans à raison d’une réunion de travail par mois. Quelque chose qui entre dans le rythme, interroge le plus sereinement possible l’ensemble de l’existence, mais au fil de l’eau de l’existence et pas comme si en trois jours on passait au crible la vie liturgique, la vie communautaire, le rapport à l’autorité, etc. Non, on va y aller pas à pas en fonction des conclusions du rapport et des recommandations, s’il y en a.
- L’inconvénient de ce long parcours, c’est qu’il faut des professionnels, des historiens et que ça dure longtemps et c’est d’ailleurs ce qui est prévu. Mais alors, c’est coûteux et donc certains disent : mais pourquoi ?
V.M. : Malheureusement ce sont des choix politiques indispensables. Vous ne pourrez pas vous en dispenser. Pas plus que les bénédictines de Montmartre ne s’en sont dispensées, pas plus que la famille Saint-Jean ne s’en est dispensée, pas plus que les Dominicains avec les frères Philippe. Et pas plus que l’Église de France, puisqu’on a mandaté Tanguy Cavallin pour continuer l’histoire dont le tome un, en quelque sorte, est celui concernant les Philippe. Je pourrais vous donner plein d’autres exemples. Mais à un moment donné, vous n’avez pas d’autre choix. Cela appartient à la gouvernance et à la gouvernance dans son rapport à la collégialité de le signifier. C’est un choix ; évidemment on met de l’argent là qu’on ne mettra pas ailleurs. Et en plus, c’est fait par des professionnels qu’il faut payer, parce que justement on ne peut pas faire faire cela par des bénévoles et que ça s’étale sur vingt ans. Il faut qu’ils puissent y consacrer du temps, sinon un temps plein, en tout cas un vrai temps, qu’ils travaillent en somme comme des professionnels.
- Est-ce qu’il y a un intérêt pour la société entière ou pour l’Église à faire ces démarches ? Une démarche comme celle-ci intéresse-t-elle en dehors de la communauté concernée ?
V.M. : Bien sûr, parce que votre communauté, pas plus que les autres, n’est pas née sur une île, surtout la vôtre. C’est pour ça que c’est important pour l’Église. Ce serait même important au-delà de l’Église ; mais le « au-delà » de l’Église n’a pas l’air pour le moment de vouloir regarder. Car tout ça met toujours en jeu des interactions sociales : les familles qui ont aidé, parfois officiellement des collectivités. Beaucoup de gens participent ou ont participé aux fondations de la première génération. Du côté de l’Église catholique, c’est fondamental parce qu’il y a toute la question de l’impunité, des soutiens. Est-ce que des responsables ecclésiastiques savaient et, si oui, que savaient-ils ? Qu’en ont-ils fait ? Il ne s’agit pas de faire des chasses à l’homme, parce que ce serait bien scandaleux, bien contraire à la dignité humaine et à l’évangile. Mais il s’agit de pouvoir comprendre pour que ceci ne puisse jamais se reproduire avec personne et que cela nous transforme dans nos rapports dans les communautés, dans le rapport à la gouvernance et dans cette question si compliquée pour l’Église catholique du rapport charismatique. Qu’est-ce qu’on observe à travers toutes ces figures ? On observe en fin de compte que les hommes soi-disant ou réellement charismatiques ont une puissance phénoménale d’aveuglement de leur entourage. Comme si le côté prophète, ou considéré comme prophétique à un moment donné, aveuglait tout jugement, tout discernement alentour.
Donc cela importe pour l’Église et, dans votre cas, pour l’archidiocèse de Paris, cela me paraît fondamental. Parce que ce n’est pas le nombre de cardinaux qui ont manqué en termes de soutien inconditionnel. La question n’est pas le soutien, c’est l’inconditionnalité du soutien qui fait qu’on ne regarde rien de l’intérieur. On se dit : ce charisme ou cette intuition, c’est magnifique. Mais il n’empêche qu’il faut voir de près comment sont mis en œuvre les vœux, ce qu’il en est de la liberté de conscience, des choses élémentaires qui sont dans le Droit Canon depuis fort longtemps. Pour moi, oui, c’est un enjeu pour l’Église de France, et particulièrement l’Église de Paris. On aurait pu penser d’ailleurs, qu’il participe au financement de votre étude parce que vous êtes de droit diocésain. Ils ne peuvent pas prétendre qu’ils ignoraient votre existence. Un petit groupe dans la forêt de Fontainebleau, on peut toujours dire qu’on ne savait pas qu’il existait. Mais pour vous vraiment personne ne peut dire ça. Je trouve qu’il y a une responsabilité morale très forte de l’Église locale. Et il faut aussi espérer que ces rapports, permettent aussi aux diocèses de s’interroger. C’est l’autorité ecclésiastique qui reconnaît la communauté et qui en est le garant.
- Quels sont les chantiers qui, selon vous, sont encore à entreprendre ?
V.M. : Je pense que vous les avez entamés. Pour moi, il y a toute la question des vœux, qui est un chantier colossal qu’on a à peine commencé, je pense. Pour le vœu d’obéissance, ça va de soi : comment l’obéissance a pu être dévoyée en soumission ? Comment elle n’a plus été l’obéissance des fils et des filles libres, mais pour prendre une formule un peu dure, la soumission des esclaves ? Ou en tout cas la soumission qui ne tient plus compte de la conscience individuelle, des libertés fondamentales.
La question de la vie commune, chez vous comme dans d’autres lieux, est la question de l’équilibre. Vous avez une vie magnifique, mais qui est compliquée. Dire à la fois : on est non seulement de ce monde, mais dans ce monde, donc on travaille ; et en même temps on a une vie contemplative forte. Forcément ça a des limites biologiques et d’équilibre psychique, tout simplement. Donc cette question de l’équilibre se pose forcément.
Je vois aussi la question de la conversation, c’est-à-dire : quels sont les lieux de conversation entre vous, entre communautés, avec la gouvernance. Pour prendre le terme cher à l’Église désormais, je ne sais pas s’il faut appeler cela des lieux synodaux, mais en tout cas des lieux de conversation qui soient suffisamment libres. C’est-à-dire finalement : quelles sont les lignes transversales. Le drame de la vie religieuse, c’est quand tout est coupé en tranches, ce qui est très destructeur psychiquement. Par exemple, la capacité à la conversation, à exprimer de la liberté de pensée, qui soit respectueuse évidemment, à pouvoir dire ce qui inquiète ou ce qu’on désire.
Peut-être quelque chose qui peut vous aider, ou en tout cas interroger dans la communauté, ce serait de reprendre ce qu’avait voté la Corref en novembre 2023 sur les droits des religieuses et religieux (à lire ici). L’Assemblée générale a voté une Charte des droits. On a voulu insister sur les droits puisque c’était dans le cadre post-CIASE de la lutte contre les abus. Je pense que cela peut éclairer. On n’a rien inventé, on a simplement compilé les droits existants dans le Droit canonique mais qui étaient épars. On les a rassemblés, on les a quand même passés au crible de hauts magistrats, on s’est référé à la Cour européenne des droits de l’homme, pour nous assurer quand même que tout était cohérent en termes de droits fondamentaux, de liberté fondamentale. Cela peut aider justement à interroger. Par exemple, le droit à la formation, certains supérieurs majeurs ne penchaient pas pour le mettre ; mais on a vu plein de communautés où il n’y avait guère de formations.
- Vous avez parlé aussi d’autres communautés comme les Dominicains, les Bénédictines. Comment, selon vous, ces communautés ont réussi à changer de culture quand il y a eu des déviances dans le passé ? Il est difficile de changer la culture de l’institution. En ces années on a réussi à faire des travaux importants, mais la culture reste, comme si c’était un terrain, une terre qu’on ne peut changer.
V.M. : C’est très juste ce que vous dites, je pense que c’est le défi le plus lourd. Et aujourd’hui, nul n’est capable de vous répondre parce que nul n’est capable de dire que la culture change enfin. Je pense que la seule chose possible, la seule vigilance, est en fin de compte les visites extérieures régulières. Il faudrait pouvoir organiser des visites, non pas canoniques, non pas ecclésiastiques, je ne sais pas comment il faut les nommer… Elles ne peuvent être faites qu’avec l’accord de la communauté, puisque ce n’est pas dans le Droit. Mais dire : tous les deux ans, nous acceptons que trois personnes, hommes et femmes, un psy, un juriste, une assistante sociale, … – des gens qui à la fois ont du bon sens, l’habitude de sentir et, en même temps, sont bienveillants – viennent passer quelque temps, quelques jours, dans les communautés et renvoient une photographie. Je ne vois pas d’autre manière parce que vous, vous ne pourrez pas être obsédé tous les matins en vous disant : mais est-ce que vraiment on change ? C’est impossible, sinon cela rend la vie infernale.
Peut-être – mais ça, je pense que vous le faites aussi – faut-il par ailleurs passer au crible autant que faire se peut les écrits, non pas seulement les écrits fondateurs, mais les écrits contemporains. Et pas seulement les Constitutions, parce que cela passe dans des textes liturgiques, dans des choses beaucoup plus fines que les Constitutions que nous ne lisons pas tous les matins non plus. C’est un travail aussi à faire : tranquillement, mais à faire.
- Une dernière question : est-ce que vous avez des recommandations à faire ?
V.M. : Je pense que vous avez déjà beaucoup de recommandations particulières à travers vos assistants apostoliques, donc je ne veux pas non plus en rajouter, et puis je n’ai évidemment pas du tout la même acuité de regard qu’eux. Mais je pense que vous avez entamé un vrai travail. Je ne suis pas capable de dire où en est ce travail et s’il y a un décalage entre le travail que vous avez entamé et l’appréciation qu’en portent des sœurs ou des frères sortis il y a quelques années. C’est inévitable. Eux, pour peu qu’ils aient souffert, forcément, ils vont dire : tout ça c’est du pipeau, c’est de l’habillage ; Jérusalem est championne du monde de la communication, donc ça n’est rien d’autre qu’une vaste opération de communication. On ne peut pas l’éviter, et c’est normal qu’ils soient dans ces sentiments parce qu’il y a ce décalage qui se produit. Pour moi, vous êtes vraiment en travail. Qu’il est loin d’être terminé, vous le savez mieux que moi. Et donc toute la difficulté, c’est la persévérance.
Le travail que vous faites, ce n’est pas un dossier que vous avez ouvert et que vous allez refermer au prochain chapitre général ou deux ans après, c’est quelque chose qui doit accompagner la Communauté sur un long terme.
Propos recueillis par sœur Marlene et Paul-Hervé Vintrou

COMPLÉMENT À LA LETTRE D’INFORMATION N°8 – MARS 2025
Pourquoi mener un travail historique ?

Interview et regard de sœur Véronique Margron,
présidente de la Conférence des Religieux et Religieuses de France (Corref)

- Dans le processus de réforme que nous vivons, il nous a été demandé un travail historique. Ce travail est actuellement dirigé par le professeur Jean Pascal Gay de l’université de Louvain. A vos yeux, pourquoi est-il important pour une communauté aujourd’hui de relire son histoire ?
V.M. : Pour une communauté, il est toujours fondamental de relire son histoire, car une communauté religieuse est un récit et, par définition, un récit s’inscrit dans le temps. Il trouve sa source dans un moment, lui-même lié à un contexte ecclésial, social, politique, culturel, et ensuite c’est un récit porté par les personnes qui ont vécu de cette tradition tout au long de l’histoire de la communauté. Pour toute communauté, il est donc fondamental de relire son histoire, et pas seulement pour des communautés qui ont des soucis avec leurs fondateurs ou avec telle ou telle page de l’histoire. Car le propre de la vie religieuse est d’inscrire ses pas dans le récit de celles et ceux qui nous précèdent et d’espérer que nos propres pas donneront goût à d’autres, demain, d’y inscrire leurs propres pas. Cette dimension est essentielle, et d’autant plus essentielle pour des communautés où ont été opérées des déviances, des abus, des situations de souffrance liées à un moment de l’histoire en interne, pour arriver à recontextualiser : qu’est-ce qui a rendu possible ces abus ou ces déviances ? Pourquoi n’ont-elles pas, à l’époque, été signalées, dénoncées ? Quel est le contexte environnant, ecclésial, qui a favorisé l’impunité ? Et comment situer cette histoire particulière dans la grande histoire de la communauté ? Donc oui, c’est absolument fondamental.
- Quels risques y aurait-il à interroger l’histoire ? Ne vaut-il pas mieux laisser les ombres du passé pour s’ouvrir à l’avenir ?
V.M. : Ce sont les risques de la clarté ou de la vérité. Ou, en tout cas de la véracité, la vérité en train de se faire. À partir du moment où des témoins sont morts, c’est toujours difficile de dire qu’on va faire la vérité ; mais quelque chose de l’ordre de la vérité historique, comme on parle de la vérité judiciaire, qui n’est qu’une part de la vérité évidemment, peut faire peur parce qu’elle peut faire mal et que personne d’entre nous, et pas plus nos communautés religieuses, ne souhaite se confronter à des choses difficiles de leur histoire. Les choses difficiles de l’histoire, d’une manière ou d’une autre, nous remettent en cause aujourd’hui, interrogent nos manières de vivre aujourd’hui. Si je prends une page très ancienne de l’ordre de saint Dominique qui est la participation à l’Inquisition, ça remonte très loin, mais cela étant, ça interroge le rapport à la vérité, qui est la devise de l’ordre de saint Dominique : quand est-ce que le rapport à la vérité devient tellement dogmatique qu’il peut en devenir totalitaire ou excluant, voire oppressant envers d’autres, qui ne partageraient pas cette vérité telle que pensée par l’Église catholique par exemple, ou par les Dominicains de l’époque ou d’aujourd’hui ? Faire l’histoire, ce n’est pas seulement faire tomber éventuellement les statues du fondateur. Cela peut être vrai, mais c’est un aspect affectif. Interroger le présent est plus difficile et, évidemment, c’est pour cela qu’il est important de le faire. Si vous lisez le moindre ouvrage sur la question des secrets de famille, vous voyez que c’est ce qui se transmet le mieux, puisque ça se transmet de façon inconsciente. Il n’y a pas pire qu’un secret de famille qui ronge de l’intérieur sans que les générations suivantes comprennent pourquoi ça les ronge.
- En quoi cela concerne-t-il les membres nouvellement arrivés en communauté ou qui désireraient y entrer ?
V.M. : C’est utile pour les nouveaux car on ne peut pas mener une vie religieuse, entrer dans une communauté sur des illusions. Sur un type d’idéal, oui, heureusement, sur un désir de vie parfaite au sens de l’Évangile, pas parfaite au sens de la perfection morale, mais au sens d’essayer de suivre le Christ et de vivre dans le désir du Père. Tout cela ne peut se faire sur une illusion, sur un faux-semblant. Tout cela ne peut se faire sur un récit tronqué. Entrer dans la vie religieuse, ce n’est pas comme devenir prêtre diocésain, par exemple. Entrer dans la vie religieuse, c’est mettre ses pas dans les pas de ceux et celles qui nous ont précédé dans ce même récit. Si vous êtes prêtre diocésain et que vous entrez au séminaire dans un diocèse où il y a eu des choses terribles, c’est dramatique et mieux vaut le savoir, mais vous ne mettez pas vos pas dans ceux qui vous ont précédés. Dans la vie religieuse si, sinon on ne s’appellerait pas dominicaine, on ne s’appellerait pas communauté de Jérusalem. Le fait d’entrer dans un récit singulier oblige à ce labeur de vérité autant qu’il est possible. Sinon, pour reprendre une image évangélique, on construit sur du sable pour les nouvelles générations.
- Comme vous le savez, nos communautés ont vu partir ces dernières années beaucoup de leurs membres. Selon votre expérience, quels outils ou aides fournit le travail historique pour pouvoir relire ces départs, précédés souvent par des expériences d’abus spirituel ou des dysfonctionnements ?
V.M. : C’est difficile de vous répondre, mais je pense que la question est de savoir comment le travail historique ou socio-historique, parce qu’il est aussi toujours au croisement entre la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, comment ce travail est mis à disposition et travaillé par les communautés. S’il n’est pas travaillé par les communautés, il ne sert à rien. Si c’est seulement pour être publié à l’extérieur en disant : ‘Voilà on a fait le travail’, non seulement ça ne sert à rien, mais ça peut être profondément décourageant. Donc il n’est efficace – pour sa part parce qu’il ne peut pas être le seul lieu –, il n’a de fécondité, de pertinence pour la communauté que dans la mesure où elle va prendre les moyens de le travailler. C’est donc à voir avec l’équipe d’historiens pour qu’ils donnent une sorte de guide pédagogique. Tout le monde n’étant pas historien, le résultat du travail n’est pas toujours facile à lire. Qu’est-ce qui est mis à disposition pédagogiquement ?
Et puis qu’est-ce qui est mis à disposition comme tiers pour aider à travailler ? Peut-être que dans une communauté il est trop difficile de relire les départs. Il faut donc un tiers. Un tiers neutre qui peut être un ami de la communauté, pas forcément un psychologue ou un historien, mais simplement un ami de la communauté qui est suffisamment à distance pour ne pas prendre parti, mais qui est profondément bienveillant, évidemment.

V.M. : Le danger que je vois dans un certain nombre de lieux, c’est que le travail est fait et qu’au moment même où il a été fait, il tombe dans une sorte de déni. La communauté ne s’en saisit pas. Elle le lit de loin, écoute la synthèse, mais cela n’a pas d’effet de transformation. Car la question est là : ce n’est pas simplement de dire que nous avons l’obligation éthique, évangélique, de faire la clarté, autant que faire se peut, sur des pages sombres. Le but, c’est de dire comment ça nous transforme pour que nous soyons plus évangéliques aujourd’hui. Plus conforme à l’Évangile et donc plus conforme à l’humain, à la dignité humaine. Et cela, c’est un travail au long cours. Il ne suffit pas d’avoir fait le rapport, de le publier et d’en faire la synthèse. Ce travail-là doit être fait au fil de l’eau, au fil de la vie. Ne serait-ce que par la confrontation à ce travail et à la compréhension des abus, des situations de souffrance, de ceux ou celles qui sont partis ou qui sont restés. Pour moi, l’enjeu est donc d’avoir un tiers qui tient bon.
- Certains de ceux qui sont partis sont apaisés et d’autres sont encore très meurtris et bouleversés. Est-ce qu’on peut aller vers eux avec ce travail de relecture ou est-ce que c’est intrusif de se retourner vers eux pour relire ensemble cette histoire ?
V.M. : Il faut leur demander à chacun, il ne peut pas y avoir de réponse collective, ça dépend des itinéraires individuels. Tout dépend de ce que les personnes ont vécu depuis qu’elles sont parties. Mais je dirais que ça peut vite être intrusif. Est-ce que beaucoup le veulent ? Je ne sais pas si c’est le cas pour vous, à Jérusalem, mais je vois dans d’autres communautés que non seulement beaucoup ne veulent plus en entendre parler, mais qu’il faut qu’ils n’en entendent plus parler pour pouvoir mener leur vie. À un moment donné, il faut quand même s’arracher. Cela ne veut pas dire qu’on a oublié à l’intérieur de soi évidemment, mais il faut s’arracher parce qu’il faut mener sa vie. Il faut être responsable, trouver du travail, faire toutes les choses pour lesquelles il n’y a plus de communauté pour vous soutenir. Je pense donc qu’il faut leur communiquer, leur dire qu’éventuellement vous êtes à leur disposition pour en parler s’ils le souhaitent. C’est bien, mais pas plus, parce je vois des frères et des sœurs qui ont quitté depuis des années et qui dans leur tête sont toujours attachés et ça peut être très problématique pour leur insertion aujourd’hui. La vie, c’est dur, donc ça requiert de l’énergie et on ne peut pas mettre son énergie partout.
- Il y a aussi souvent un décalage entre ceux qui disent que le travail de réforme est juste un replâtrage qui maquille les problèmes de fond, et à l’intérieur, ceux qui disent : on en a assez, on n’en peut plus. Comment alors trouver un juste équilibre dans ce travail ?
V.M. : C’est bien difficile, c’est vrai. Il faut être honnête, je pense qu’on navigue forcément à vue. C’est impossible de trouver à tout moment la bonne mesure. Et puis il y a des moments paroxystiques, par exemple la sortie de votre rapport. Le chemin – mais je le dis vraiment avec précaution – c’est sans doute le travail au long cours. Que ce ne soit pas le centre de la vie, mais un travail long. Cela va dépendre de l’importance du rapport effectué, mais c’est un travail dans les communautés d’au moins deux ans. Que ça ne devienne pas obsessionnel, mais en même temps qu’on ne se dise pas : ‘allez, on y passe trois jours de session, et après on n’en parle plus’. C’est un travail de deux ans à raison d’une réunion de travail par mois. Quelque chose qui entre dans le rythme, interroge le plus sereinement possible l’ensemble de l’existence, mais au fil de l’eau de l’existence et pas comme si en trois jours on passait au crible la vie liturgique, la vie communautaire, le rapport à l’autorité, etc. Non, on va y aller pas à pas en fonction des conclusions du rapport et des recommandations, s’il y en a.
- L’inconvénient de ce long parcours, c’est qu’il faut des professionnels, des historiens et que ça dure longtemps et c’est d’ailleurs ce qui est prévu. Mais alors, c’est coûteux et donc certains disent : mais pourquoi ?
V.M. : Malheureusement ce sont des choix politiques indispensables. Vous ne pourrez pas vous en dispenser. Pas plus que les bénédictines de Montmartre ne s’en sont dispensées, pas plus que la famille Saint-Jean ne s’en est dispensée, pas plus que les Dominicains avec les frères Philippe. Et pas plus que l’Église de France, puisqu’on a mandaté Tanguy Cavallin pour continuer l’histoire dont le tome un, en quelque sorte, est celui concernant les Philippe. Je pourrais vous donner plein d’autres exemples. Mais à un moment donné, vous n’avez pas d’autre choix. Cela appartient à la gouvernance et à la gouvernance dans son rapport à la collégialité de le signifier. C’est un choix ; évidemment on met de l’argent là qu’on ne mettra pas ailleurs. Et en plus, c’est fait par des professionnels qu’il faut payer, parce que justement on ne peut pas faire faire cela par des bénévoles et que ça s’étale sur vingt ans. Il faut qu’ils puissent y consacrer du temps, sinon un temps plein, en tout cas un vrai temps, qu’ils travaillent en somme comme des professionnels.
- Est-ce qu’il y a un intérêt pour la société entière ou pour l’Église à faire ces démarches ? Une démarche comme celle-ci intéresse-t-elle en dehors de la communauté concernée ?
V.M. : Bien sûr, parce que votre communauté, pas plus que les autres, n’est pas née sur une île, surtout la vôtre. C’est pour ça que c’est important pour l’Église. Ce serait même important au-delà de l’Église ; mais le « au-delà » de l’Église n’a pas l’air pour le moment de vouloir regarder. Car tout ça met toujours en jeu des interactions sociales : les familles qui ont aidé, parfois officiellement des collectivités. Beaucoup de gens participent ou ont participé aux fondations de la première génération. Du côté de l’Église catholique, c’est fondamental parce qu’il y a toute la question de l’impunité, des soutiens. Est-ce que des responsables ecclésiastiques savaient et, si oui, que savaient-ils ? Qu’en ont-ils fait ? Il ne s’agit pas de faire des chasses à l’homme, parce que ce serait bien scandaleux, bien contraire à la dignité humaine et à l’évangile. Mais il s’agit de pouvoir comprendre pour que ceci ne puisse jamais se reproduire avec personne et que cela nous transforme dans nos rapports dans les communautés, dans le rapport à la gouvernance et dans cette question si compliquée pour l’Église catholique du rapport charismatique. Qu’est-ce qu’on observe à travers toutes ces figures ? On observe en fin de compte que les hommes soi-disant ou réellement charismatiques ont une puissance phénoménale d’aveuglement de leur entourage. Comme si le côté prophète, ou considéré comme prophétique à un moment donné, aveuglait tout jugement, tout discernement alentour.
Donc cela importe pour l’Église et, dans votre cas, pour l’archidiocèse de Paris, cela me paraît fondamental. Parce que ce n’est pas le nombre de cardinaux qui ont manqué en termes de soutien inconditionnel. La question n’est pas le soutien, c’est l’inconditionnalité du soutien qui fait qu’on ne regarde rien de l’intérieur. On se dit : ce charisme ou cette intuition, c’est magnifique. Mais il n’empêche qu’il faut voir de près comment sont mis en œuvre les vœux, ce qu’il en est de la liberté de conscience, des choses élémentaires qui sont dans le Droit Canon depuis fort longtemps. Pour moi, oui, c’est un enjeu pour l’Église de France, et particulièrement l’Église de Paris. On aurait pu penser d’ailleurs, qu’il participe au financement de votre étude parce que vous êtes de droit diocésain. Ils ne peuvent pas prétendre qu’ils ignoraient votre existence. Un petit groupe dans la forêt de Fontainebleau, on peut toujours dire qu’on ne savait pas qu’il existait. Mais pour vous vraiment personne ne peut dire ça. Je trouve qu’il y a une responsabilité morale très forte de l’Église locale. Et il faut aussi espérer que ces rapports, permettent aussi aux diocèses de s’interroger. C’est l’autorité ecclésiastique qui reconnaît la communauté et qui en est le garant.
- Quels sont les chantiers qui, selon vous, sont encore à entreprendre ?
V.M. : Je pense que vous les avez entamés. Pour moi, il y a toute la question des vœux, qui est un chantier colossal qu’on a à peine commencé, je pense. Pour le vœu d’obéissance, ça va de soi : comment l’obéissance a pu être dévoyée en soumission ? Comment elle n’a plus été l’obéissance des fils et des filles libres, mais pour prendre une formule un peu dure, la soumission des esclaves ? Ou en tout cas la soumission qui ne tient plus compte de la conscience individuelle, des libertés fondamentales.
La question de la vie commune, chez vous comme dans d’autres lieux, est la question de l’équilibre. Vous avez une vie magnifique, mais qui est compliquée. Dire à la fois : on est non seulement de ce monde, mais dans ce monde, donc on travaille ; et en même temps on a une vie contemplative forte. Forcément ça a des limites biologiques et d’équilibre psychique, tout simplement. Donc cette question de l’équilibre se pose forcément.
Je vois aussi la question de la conversation, c’est-à-dire : quels sont les lieux de conversation entre vous, entre communautés, avec la gouvernance. Pour prendre le terme cher à l’Église désormais, je ne sais pas s’il faut appeler cela des lieux synodaux, mais en tout cas des lieux de conversation qui soient suffisamment libres. C’est-à-dire finalement : quelles sont les lignes transversales. Le drame de la vie religieuse, c’est quand tout est coupé en tranches, ce qui est très destructeur psychiquement. Par exemple, la capacité à la conversation, à exprimer de la liberté de pensée, qui soit respectueuse évidemment, à pouvoir dire ce qui inquiète ou ce qu’on désire.
Peut-être quelque chose qui peut vous aider, ou en tout cas interroger dans la communauté, ce serait de reprendre ce qu’avait voté la Corref en novembre 2023 sur les droits des religieuses et religieux (à lire ici). L’Assemblée générale a voté une Charte des droits. On a voulu insister sur les droits puisque c’était dans le cadre post-CIASE de la lutte contre les abus. Je pense que cela peut éclairer. On n’a rien inventé, on a simplement compilé les droits existants dans le Droit canonique mais qui étaient épars. On les a rassemblés, on les a quand même passés au crible de hauts magistrats, on s’est référé à la Cour européenne des droits de l’homme, pour nous assurer quand même que tout était cohérent en termes de droits fondamentaux, de liberté fondamentale. Cela peut aider justement à interroger. Par exemple, le droit à la formation, certains supérieurs majeurs ne penchaient pas pour le mettre ; mais on a vu plein de communautés où il n’y avait guère de formations.
- Vous avez parlé aussi d’autres communautés comme les Dominicains, les Bénédictines. Comment, selon vous, ces communautés ont réussi à changer de culture quand il y a eu des déviances dans le passé ? Il est difficile de changer la culture de l’institution. En ces années on a réussi à faire des travaux importants, mais la culture reste, comme si c’était un terrain, une terre qu’on ne peut changer.
V.M. : C’est très juste ce que vous dites, je pense que c’est le défi le plus lourd. Et aujourd’hui, nul n’est capable de vous répondre parce que nul n’est capable de dire que la culture change enfin. Je pense que la seule chose possible, la seule vigilance, est en fin de compte les visites extérieures régulières. Il faudrait pouvoir organiser des visites, non pas canoniques, non pas ecclésiastiques, je ne sais pas comment il faut les nommer… Elles ne peuvent être faites qu’avec l’accord de la communauté, puisque ce n’est pas dans le Droit. Mais dire : tous les deux ans, nous acceptons que trois personnes, hommes et femmes, un psy, un juriste, une assistante sociale, … – des gens qui à la fois ont du bon sens, l’habitude de sentir et, en même temps, sont bienveillants – viennent passer quelque temps, quelques jours, dans les communautés et renvoient une photographie. Je ne vois pas d’autre manière parce que vous, vous ne pourrez pas être obsédé tous les matins en vous disant : mais est-ce que vraiment on change ? C’est impossible, sinon cela rend la vie infernale.
Peut-être – mais ça, je pense que vous le faites aussi – faut-il par ailleurs passer au crible autant que faire se peut les écrits, non pas seulement les écrits fondateurs, mais les écrits contemporains. Et pas seulement les Constitutions, parce que cela passe dans des textes liturgiques, dans des choses beaucoup plus fines que les Constitutions que nous ne lisons pas tous les matins non plus. C’est un travail aussi à faire : tranquillement, mais à faire.
- Une dernière question : est-ce que vous avez des recommandations à faire ?
V.M. : Je pense que vous avez déjà beaucoup de recommandations particulières à travers vos assistants apostoliques, donc je ne veux pas non plus en rajouter, et puis je n’ai évidemment pas du tout la même acuité de regard qu’eux. Mais je pense que vous avez entamé un vrai travail. Je ne suis pas capable de dire où en est ce travail et s’il y a un décalage entre le travail que vous avez entamé et l’appréciation qu’en portent des sœurs ou des frères sortis il y a quelques années. C’est inévitable. Eux, pour peu qu’ils aient souffert, forcément, ils vont dire : tout ça c’est du pipeau, c’est de l’habillage ; Jérusalem est championne du monde de la communication, donc ça n’est rien d’autre qu’une vaste opération de communication. On ne peut pas l’éviter, et c’est normal qu’ils soient dans ces sentiments parce qu’il y a ce décalage qui se produit. Pour moi, vous êtes vraiment en travail. Qu’il est loin d’être terminé, vous le savez mieux que moi. Et donc toute la difficulté, c’est la persévérance.
Le travail que vous faites, ce n’est pas un dossier que vous avez ouvert et que vous allez refermer au prochain chapitre général ou deux ans après, c’est quelque chose qui doit accompagner la Communauté sur un long terme.
Propos recueillis par sœur Marlene et Paul-Hervé Vintrou